CINQUANTE ANNÉES DE PRÉPONDÉRANCE FRANÇAISE EN TUNISIE
PAR HADI ZAMANE
Edité à Paris en 1932
I) L'Enseignement
II) Quelques
aspects du milieu social
Avec notre argent on nous refuse l’instruction
PARTIE I : L'ENSEIGNEMENT
Le problème de l’enseignement
a de tout temps passionné l'opinion publique en Tunisie.
Avant l'occupation
Française Ahmed Bey, vers 1842 et plus tard Khéreddine Ministre de Sadok Bey
(1873-1877) y attachèrent une grande importance. Plus tard il faut lire dans
les journaux arabes avant leur interdiction en 1911 et dans le journal « Le
Tunisien » que dirigeait notre regretté Ali Bach-Hamba, les vigoureuses campagnes
pour la création des écoles et la diffusion de l'enseignement.
Après la Guerre le
Parti Destourien fit de l'Instruction primaire obligatoire l'un des points
essentiels de son programme et la presse arabe a apporté à la défense de cette
revendication son ardeur coutumière.
C’est que le peuple
tunisien se rend compte que l'instruction est l'un des principaux facteurs du progrès
social et économique et qu'il tient à en bénéficier.
Pour mettre en
relief l'importance que le tunisien attache à l’enseignement et les entraves
qu'il y rencontre, nous parlerons de l'organisation de l'enseignement avant et
après le Protectorat et de la part de l'initiative privée.
L'ENSEIGNEMENT AVANT 1881
I) L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
L'enseignement primaire était donné avant 1881, dans les « couttebs ». Ce sont des écoles publiques, composées d'une seule classe, où un seul maître, le « meddeb », quelquefois deux, le second, le « Moukarer » étant un assistant du premier, apprenaient aux enfants à lire et à écrire le Coran. Ces écoles sont des fondations publiques (Habous), ou privées.
Le meddeb est payé
en partie par les revenus des habous (faible rétribution annuelle en général), en
partie par les parents. Les élèves pauvres ne payaient pas - chose importante à
souligner.
Le nombre des
couttebs était considérable. On peut s'en rendre compte aujourd'hui en parcourant
certaines artères de la capitale, les villages et les Zaouias, dans les
campagnes.
Chaque Zaouia avait
et conserve encore son coutteb. Chaque village avait et conserve encore un ou plusieurs
couttebs.
Dans chaque rue, à Tunis, fonctionnait au
moins un coutteb. Dans les rues assez longues on en trouvait plusieurs. Ainsi, la
rue El Hadjamine, longue à peine de cinq cents mètres, possédait quatre
couttebs. La rue du Pacha, longue de deux cents mètres, en possédait également
quatre.
Un recensement
fait par les soins de M. Machuel, directeur de l'enseignement en Tunisie, au début
du protectorat, évalue le nombre des couttebs à l'époque, à près de 1400 fréquentés
par 21800 élèves. Tunis seule possédait 120 couttebs.
II) L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Cet enseignement était
donné à « l’Université de l'Olivier » et dans certaines autres
mosquées, notamment à Kairouan, Sousse, Sfax, Monastir Gafsa, Djerba, le Kef.
L'Université de
l'Olivier est vieille de treize siècles. Par le nombre de ses professeurs et
élèves, par le degré de son enseignement, par l'importance de sa bibliothèque,
elle occupait et occupe encore le second rang après l'Université Arabe du Caire :
l'Université de El Azhar. L'Université El Karaouyne de Fez, vient en troisième
lieu.
Le nombre des
professeurs agrégés était de quarante ; celui des assistants, de plus de
soixante et celui des élèves atteignait mille, à la veille du Protectorat.
Les élèves venus de
la province logeaient gratuitement dans les « Medersas ». Ce sont des
maisons d'étudiants bâties çà et là autour de l'Université. Au nombre de vingt-deux,
elles donnaient abri à cinq cents élèves environ.
L'Université
jouissait d'une somme considérable de revenus de fondations, habous mobilières
et immobilières, legs accumulés par les siècles et qui lui permettaient de couvrir
toutes ses dépenses.
Son organisation
actuelle date de l'année 1258 de l'Hégire ou 1842. Elle fut l'œuvre de Ahmed Bey
1er.
En 1870 le ministre
Khéreddine réunit, sous sa présidence, une commission qui réorganisa le programme
des cours conformément à l'esprit et aux exigences de cette époque, doubler le traitement
des professeurs, afin de stimuler leur zèle et instituer un recteur pour l'Université.
Ce fut l'objet du décret du 27 septembre 1870.
Cinq années plus
tard, un décret (26 décembre 1875) introduisait dans le programme des études, l'enseignement
de l'histoire, de la géographie, de la géométrie, de l'astronomie. Il instituait
également le livret universitaire et des primes à l'instruction.
Cependant, la base
même de l'enseignement restait la théologie, le droit musulman et la littérature
arabe.
LE
COLLÈGE SADIKI : Dans la même
année, le 13 janvier 1875, Khéreddine créait à côté de l'Université de l'Olivier
et grâce à l'initiative privée, un établissement d'enseignement secondaire
moderne : le Collège Sadiki, installé dans les locaux de la Direction des Habous
actuelle. On y enseignait la littérature arabe, les langues étrangères et les
sciences. Le but de ce nouvel établissement était de préparer des élèves à
recevoir l'enseignement supérieur des Universités Européennes. Et, effectivement,
un certain nombre d'élèves, une douzaine à la sortie du Collège Sadiki, furent
envoyés comme boursiers auprès des écoles et universités françaises.
L'Enseignement supérieur
était donné à l'Université de l'Olivier. Il faut signaler également l'Ecole militaire
du Bardo, fondée en 1840, par Ahmed Bey.
Citons enfin les
écoles de filles des religieuses de l'Apparition, créées en 1843 à Tunis et dans
quelques villes de l’intérieur ; l'école de garçons de l'abbé Bourgade ;
les écoles des frères de la doctrine chrétienne, le collège Saint-Louis de Carthage
(1875) et l'école de l'Alliance Israélite (1878) et enfin l'école des filles des
sœurs de Sion à Tunis et quatre écoles italiennes. Toutes ces écoles sont des établissements
privés. Elles étaient ouvertes aux tunisiens qui voulaient suivre un enseignement
purement occidental et qui y étaient effectivement représentés.
Les Tunisiens ne
sont pour rien dans la création de ces écoles, aussi les citerons-nous pour mémoire.
III) RESUME DE L’ENSEIGNEMENT AVANT 1881
Il est important
de remarquer que l'Ecole Militaire du Bardo mise à part, tous les autres établissements
scolaires placés sous le contrôle et la direction de l'Etat (Université,
Collège Sadiki) ou non (couttebs) puisaient leurs ressources en dehors du budget
de l'Etat et n'avaient à aucun moment fermé leurs portes pendant les périodes
de vicissitudes financières qui avaient précédé l'occupation.
Que la
caractéristique de cet enseignement était la gratuité à tous les degrés. Et bien :
1)
le
nombre des couttebs pour un pays qui comptait moins de deux millions
d'habitants ;
2)
la
gratuité et la stabilité de l'enseignement à tous les degrés ;
3)
l'esprit
de modernisation constante de l'enseignement qui animait le ministre Khéreddine ;
4)
l'envoi
de boursiers en Europe.
Tous ces facteurs prouvent
que la proportion des illettrés n'était pas, peut-être plus grande en Tunisie qu'en
France et dans la plupart des états européens, il y a un demi-siècle.
On nous objectera
que l'enseignement des couttebs et de l'Université de l'Olivier était à base religieuse.
C'est vrai. Mais qu'importe,
puisqu'il éclaire la conscience et la lanterne de l'individu.
D'ailleurs, l'enseignement
laïque, s'il est en honneur en France, ne date que de 1881 ; et n'est pas adopté
par la plupart des Etats européens. Il est même loin d'être la règle en Belgique :
monarchie constitutionnelle depuis un siècle et où le socialisme a construit
plus que dans n'importe quel autre état, la Russie exceptée.
L'ENSEIGNEMENT DEPUIS 1881
I) INTRODUCTION
Depuis cette date,
le nombre des couttebs diminue de plus en plus, cédant la place aux écoles primaires
laïques, où un enseignement moderne y est donné selon des méthodes pédagogiques.
L'Enseignement secondaire
est donné à Tunis au lycée Carnot, au Collège Allaoui, au Lycée Armand Fallière
pour les jeunes filles, à l'Ecole Normale d'instituteurs et l'Ecole Normale
d'institutrices ; à l'Ecole Supérieure d'Arabe.
A l'intérieur du pays,
dans les collèges de Bizerte et de Sousse.
Cet enseignement
est totalement gratuit dans les écoles primaires élémentaires, presque gratuit
dans les collèges, assez onéreux dans les Lycées.
L'Enseignement professionnel
est donné dans les écoles : Emile Loubet, Paul Cambon pour les jeunes
filles ; l'Ecole Coloniale d'Agriculture et l'Ecole Ferme de Smindja.
L'Université de l'Olivier
continuera à ouvrir ses portes et à voir le nombre de ses élèves et de ses
professeurs augmenter.
Aujourd'hui, notre
Université, avec son Annexe de Youssef Bey, compte trente professeurs agrégés
de première classe et douze de deuxième classe. Cinquante auxiliaires et
environ vingt-cinq stagiaires bénévoles.
Le nombre des
élèves est de trois mille. Les études y sont encore totalement gratuites. Le nombre
des maisons d’étudiants (mederssas) augmente. De vingt-deux il est porté à trente.
En face de
l'Université et pour compléter l'enseignement de celle-ci en matière
scientifique, un groupe de tunisiens, parmi lesquels on ne peut oublier les
noms de Si El Béchir Sfar et Si Ali Bach-Hamba, fondèrent une Université populaire :
LA KHALDOUNIA, du nom de l'historien tunisien Ibn Khaldoun, fondateur de la
Philosophie de l'Histoire.
Le Collège Sadiki est
transféré dans un très beau bâtiment qui fait l'admiration de tous ceux qui le
visitent. Son enseignement continue à être gratuit pour les externes (cent) et
pour les internes (quarante).
II) CRITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SOUS LE PROTECTORAT
Dire que la
proportion de ceux qui savent lire et écrire a augmenté depuis l'établissement du
Protectorat, cela ne fait par l'ombre d'un doute.
Un demi-siècle
nous sépare aujourd'hui de 1881. Ce même demi-siècle qui a marqué l'essor
intellectuel et économique le plus formidable que l'Humanité ait connu jusqu'à
ce jour.
On ne peut
admettre que la Tunisie, où les vieilles civilisations Phénicienne, Grecque,
Romaine et Arabe avaient laissées d’éternels vestiges, terre ouverte sur
l'Europe et l'Asie reste spectatrice de révolution des autres nations.
Bien au contraire,
les efforts et les luttes que les Tunisiens y ont manifesté d’une façon
permanente depuis 1881 est l'une des plus belles pages de l'histoire du Peuple Tunisien
sous le Protectorat Français.
D'autre part,
l'œuvre du Protectorat en la matière, pour si imposante qu’elle puisse paraître
à première vue, n'est ni en rapport, avec les besoins et le budget du pays, ni
désintéressée a 1’egard de la population tunisienne. Toutes ces idées se dégageront
d'elles-mêmes, de l'exposition des faits que nous allons entreprendre.
Nous parlerons
successivement :
1)
De
l'insuffisance des écoles primaires ;
2)
De
l'insuffisance des écoles professionnelles ;
3)
De
l’insuffisance de l'enseignement secondaire ;
4)
De
l’insuffisance de l'enseignement de la langue arabe ;
5)
De
la déviation du Collège Sadiki de son véritable but ;
6)
De
la réforme de l'enseignement de l'Université ;
7)
De
l'enseignement supérieur ;
8)
De
l'enseignement des filles ;
9)
De
l'école de Djouggar ;
10)
Et
enfin de l'attitude du Gouvernement à l'égard de l'initiative privée.
1) L'INSUFFISANCE DES ÉCOLES PRIMAIRES
L'enseignement primaire
élémentaire qui devait être obligatoire dès le début du Protectorat, n'est
donné aux petits tunisiens qu'avec parcimonie.
Au début du protectorat,
on a commencé par créer des écoles dans les centres de colonisation et dans les
grandes villes. Devant l'envahissement de ces écoles par l'élément tunisien, on
a augmenté le nombre des écoles, créé d'autres dans des villages purement
tunisiens sous la pression de la population, mais le nombre des écoles
primaires reste encore très insuffisant si on en juge par les statistiques de l'armée :
Pour les jeunes gens tunisiens recrutés dans
les années 1920, 1925 et 1928 on trouve :
a) Sur 1300
inscrits en 1920, 121 savaient lire et écrire l’arabe, soit 9,3%
12 savaient lire
et écrire le français, soit 0,9% ;
14 savaient lire et
écrire l'arabe et le français, soit 1,1% ;
En tout 147 soit 11,3
%.
b) Sur 1222 inscrits
en 1925, 305 savaient lire et écrire l'arabe, soit 25,0% ;
17 savaient lire et
écrire le français, soit 1,4% ;
21 savaient lire et
écrire l'arabe et le français, soit 1,7% ;
En tout 343 qui
savaient lire et écrire, soit 28,1 % ;
c) Et enfin, sur 1293
inscrits en 1928, 304 savaient lire et écrire l'arabe, soit 23,5% ;
46 savaient lire
et écrire le français, soit 3,6% ;
54 savaient lire
et écrire l'arabe et le français, soit 4,2% ;
En tout 404 qui
savaient lire et écrire, soit 31,2% [1].
Si l'on tient
compte que les jeunes gens nés dans la capitale, les élèves maîtres, les élèves
du Collège Sadiki ; ceux qui ont obtenu le certificat d'études et ceux des
centres d'enseignement arabe qui ont réussi à l'examen d'équivalence, sont
dispensés du service militaire, on conçoit aisément que la statistique ci-dessus
vise les enfants des ouvriers et des paysans pauvres[2]. Que la proportion de ceux
qui savent lire et écrire le français, c'est à dire ceux qui ont profité de l'enseignement
de l'école française laïque ou congréganiste et qu'enfin les couttebs rendent encore,
en l'absence d'école modernes, d’utiles services à la population tunisienne.
Est-ce à dire que nous
préférons l'enseignement des couttebs à l'enseignement des Ecoles laïques et
qu'il n'appartient qu'à nous-mêmes d'envahir les écoles que le gouvernement construit
pour nous ? Il n'en est rien. Au début de chaque année scolaire, des milliers
d'enfants voient les portes des écoles se fermer à leur nez, faute de place pour
les recevoir et les élèves qui ont dépassé l'âge de quatorze ans, sont renvoyés
d'office, même s'ils sont dans la classe du certificat d'études, pour faire place
aux plus jeunes. Mais par contre les portes des écoles primaires sont largement
ouvertes aux petits français et italiens.
Il serait désolant,
dit M. Mustapha Kaâk, membre du Grand Conseil dans son rapport sur le budget de
l’enseignement pour l'année 1930 :
« Il serait désolant que la Tunisie continuât
à offrir le spectacle d'un déséquilibre choquant d'une population de près de 2000000
d'habitants moins avantagé sous le rapport de l'instruction que 200000 autres
habitants. N'est-il pas inquiétant en effet de constater que sur les 69237
élèves que comptent nos 467 écoles primaires publiques et privées, 28829
seulement sont indigènes, qu'à peine 637 de ces derniers ont été admis en juin
dernier, au C.E.P.E. et que sur les 637 (les admis en octobre ne sont pas comptés),
à peine 306 ont réussi à trouver place cette année, dans les établissements d'enseignement
secondaire et primaire supérieur, alors que le nombre des élèves nouveaux dans
ces établissements est de 892 unités ».
Comme on le voit, l'éloquence
des chiffres en l'occurrence est loin d'être un vain cliché de rhétorique[3] ».
2) INSUFFISANCE DE L'ENSEIGNEMENT PROFFESSIONNEL
La Tunisie est un
pays essentiellement agricole. Le Gouvernement se devait de répandre sur une
vaste échelle l'enseignement de l’agriculture et des industries qui s'y rattachent.
Chaque centre agricole devait avoir son école pratique d'agriculture et de
mécanique agricole. Il en est de même de l'enseignement relatif à la culture de
l'olivier, du dattier el des arbres fruitiers. Or, en fait d'écoles d'agricultures,
la Tunisie en possède deux :
a) L'Ecole Coloniale,
où le niveau du concours d'entrée étant élevé -degré du baccalauréat de Mathématiques
élémentaires- le nombre des étudiants tunisiens a été, pratiquement, nul
jusqu'à ce jour.
b) L'Ecole-Ferme
de Smindja. Cette école est réservée exclusivement aux tunisiens. Le nombre des
élèves y est de quarante.
On voit donc que
cet enseignement est excessivement maigre et on s'explique aisément la
difficulté que rencontrent les Tunisiens pour améliorer leur outillage
agricole.
Maintenant, en
fait d'enseignement des industries agricoles, on peut dire qu'il n'en existe
encore rien.
Le reste de l'enseignement
professionnel (tissage, menuiserie, couture. etc.) est annexé aux programmes de
certaines écoles primaires de Tunis et de certaines villes de l'intérieur,
telles : Bizerte, Ferryville, Gabès, Gafsa. Mais cet enseignement est trop
insuffisant pour exercer un attrait sur les élèves qui préfèrent préparer auparavant
le certificat d'études primaires. Aussi, leur nombre, dans ces écoles, est-il
infime : 668 seulement pour l'année 1928.
Cet enseignement a
été condamné non seulement par les élèves et leurs parents, mais également par
le Grand Conseil et par la Conférence Nord-Africaine. Dans le rapport sur le
budget de l'enseignement précité, le rapporteur fait remarquer à ce sujet ce
qui suit :
« La Commission a remarqué que l'enseignement
professionnel n'a guère progressé ; elle signale encore une fois les
inconvénients des combinaisons de demi-temps et de temps complet, condamnées
pourtant par 1a conférence Nord-Africaine et par l’expérience ».
On ne peut donc y
attacher de l'importance.
3) INSUFFISANCE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Nous voici, après
un demi-siècle d'occupation. Le budget atteint déjà un demi-milliard et la Tunisie
ne possède qu'un seul Lycée. Il y a le Collège Allaoui, un Collège à Bizerte et
un autre à Sousse, qui a ouvert dernièrement ses portes, mais nous ne pouvons-nous
empêcher d'objecter que le nombre des élèves tunisiens s'arrête de croître par suite
du manque de place, que les élèves qui sont venus un peu tardivement à l'enseignement
et qui ont dépassé la dix-huitième année, sont renvoyés du lycée pour laisser
de la place, même s'ils sont dans les classes supérieures et s'ils y occupent
un rang très honorable et que Sfax et sa banlieue, la capitale économique de la
Tunisie et la ville la plus peuplée après Tunis, ne possède ni Lycée ni
Collège.
4) DE L'INSUFFISANCE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE DANS LES ECOLES DU
GOUVERNEMENT
Les programmes des
écoles laïques ne réservent pas une place suffisante pour l'enseignement de la langue
arabe. C'est ainsi qu'à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires,
l'arabe est considéré comme une matière à option. L'élève peut choisir entre
l'épreuve de dessin et celle de l'arabe. Grave lacune, car 1'arabe est l'une
des deux langues officielles du pays et surtout notre langue nationale.
Cause de retard
dans les études et de surmenage également pour les enfants, car les parents
tiennent à la culture arabe et quand ils n'envoient pas, dès le début, leurs
enfants au Coutteb, ils leur font prendre des leçons particulières d'arabe, pendant
les vacances ou le plus souvent, en dehors des heures scolaires.
La Presse tunisienne
et nos délégués au Grand Conseil ont attiré continuellement l'attention du Gouvernement
là-dessus... rien n'y fit.
5) LA DÉVIATION DU COLLÈGE SADIKI DE SON PROPRE BUT
En prenant en
mains les administrations du pays et en confiant la direction à des fonctionnaires
français ignorant la langue arabe, le Gouvernement du Protectorat devait faire appel
à un nombre considérable de traducteurs et d'interprètes. Le collège Sadiki cessa
de préparer ses élèves à l'enseignement supérieur et devint une pépinière
d'interprètes. On supprima l'enseignement des langues étrangères et on encombra
le programme des études d'une telle gamme de traductions administratives, que
les études du collège finirent par rebuter les esprits les plus dociles. Effectivement,
le nombre des élèves de chaque promotion qui débute en sixième est de trente et
va en diminuant jusqu'à tomber à cinq ou six en seconde et en première. Fort heureusement,
le directeur actuel[4]
du collège, tente dans la mesure où la direction de l'enseignement le lui permet,
de redresser le programme des études et de donner satisfaction à l'opinion tunisienne.
Mais il est à
remarquer que si l'élan imprimé au Collège Sadiki par Khéreddine n'avait pas été
brisé par le Protectorat, il y aurait eu en Tunisie et bien avant la guerre,
plus de trois médecins, des ingénieurs et des professeurs tunisiens qui
auraient apporté leur contribution au relèvement social et économique de leurs
compatriotes, contribution qui aurait été certainement efficace grâce à leur connaissance
de la langue arabe et à la confiance que la population musulmane témoigne aux
siens.
6) DE L'OBSTINATION QUE MET LE GOUVERNEMENT A POURSUIVRE LA RÉFORME DE
L’UNIVERSITÉ DE L'OLIVIER COMMENCÉE PAR KHÉREDDINE
L'enseignement de l'Université
de l'Olivier ne faisant pas place aux matières scientifiques, a amené les étudiants
à en demander au Gouvernement la réorganisation. Quand de nos jours, un jeune homme
entre dans la vie active, il ne lui suffit plus de s'armer de théologie et de littérature.
Il lui faut des armes plus concrètes : la comptabilité, la mécanique, en
un mot, les sciences positives. Et un gouvernement soucieux de l'intérêt général
ne pouvait attendre qu'on lui en fasse la remarque. Malheureusement ce ne sont
pas de simples remarques qu'on a faites au gouvernement pour entreprendre la réforme
de l'enseignement à l'Université. L'action des étudiants, dans ce sens, a été
dans ces dernières années tellement vive, qu'elle a gagné la solidarité de la population
tunisienne et qu'elle mérite d'être relatée.
Aperçu sur l'action
estudiantine - Une campagne de presse menée en 1909 pour attirer l'attention du
Gouvernement sur la nécessité de moderniser l'enseignement de l'Université n'avait
produit aucun effet. Les étudiants se mettent alors en grève. Quelques jours
après, les dirigeants du mouvement furent arrêtés et emprisonnés. Les étudiants,
n'étant pas habitués à manier le redoutable instrument qu'est la grève, terrorisés
par ces mesures administratives, reprirent les cours non sans obtenir la libération
de leurs camarades et la promesse que leurs doléances seraient examinées. Une Commission
se réunit en effet et introduisit dans le programme de l'examen de fin d’études,
des matières nouvelles pour lesquelles elle n'avait pas créé de chaire spéciale.
Elle avait compté pour cela sur les cours professés à la Khaldounia.
Deux ans plus
tard, le mouvement reprend par une campagne de presse, mais toute la presse
arabe, suspendue en 1911 lors de la bagarre du Djellaz et l'état de siège
proclamé et maintenu avec la grande guerre, tout rentre dans l'ordre jusqu'en 1919.
Les journaux arabes réapparaissent. Les étudiants recommencent une nouvelle campagne
qui aboutit en 1926 à la réunion par le Gouvernement, d'une nouvelle Commission
pour étudier la réforme de 1’enseignement de l'Université. Cette Commission tint
réunion sur réunion, mais ne publia aucune décision, jusqu'au jour, où en 1928,
apparut au journal Officiel, le texte réorganisant l’examen du notariat et y introduisant
des matières non enseignées à l'Université. Jusque-là la fonction de notaire
était exclusivement réservée aux étudiants de l'Université de l'Olivier. C'était
également pour eux la seule fonction spécialisée à laquelle leur diplôme leur
permettait d'aspirer. Ce fut le signal d'un vigoureux mouvement en faveur de la
réforme : ce fut la grève. Mais, cette fois-ci, une grève mieux dirigée,
caractérisé par le vide autour de l'Université et le calme. Pour ne pas donner
prise au Gouvernement, les noms des dirigeants de la grève restent secrets. La lutte
dure. La police exaspérée, arrête quatre étudiants, au hasard, qu'elle accuse d'avoir
entravé la liberté de l'enseignement. En même temps que le Gouvernement, dans le
même esprit d'intimidation fermait l'Université. Mais les étudiants redoublent
d'énergie et de courage. Ils gagnent à leur cause la population tunisoise qui, voyant
l'Université fermer ses portes pour la première fois depuis sa création, proclame,
le 20 janvier 1928 une magnifique grève de solidarité. Les dockers et les artisans
en grève paralysent quelque peu l'activité économique de la ville de Tunis. Le
Résident Général ouvre alors les yeux, car le mouvement avait tendance à se
généraliser.
Dans la même
journée, le journal arabe Ez-Zohra, publiait en supplément, un appel du Résident
Général[5], invitant les étudiants à reprendre
leurs études et leur promettant de faire réviser le décret nouvellement
promulgué sur les examens du notariat et le programme des études de
l'Université.
Les étudiants
étaient déjà à leur quarantième jour de grève. Ils cédèrent. Les emprisonnés
furent aussitôt relâchés. Une commission fut constituée, en effet, pour re-procéder
à la révision du programme des études... mais les élèves attendent encore ses conclusions.
N'oublions pas de signaler
que les étudiants n'ont pas désarmé. Ils continuent la lutte par le journal et la
grève. Et c'est ainsi qu’ils firent, en la fin de l'année 1929, une grève de 24
heures et une autre en 1930, de 48 heures.
7) L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Il n'existe, en
Tunisie que pour le Droit. Mais rien pour le reste. Pas même une classe de
Mathématiques spéciales au Lycée de Tunis, pour éviter aux élèves qui désirent
préparer les grandes écoles, des frais de séjour en France.
8) L’ENSEIGNEMENT DES FILLES
En Tunisie, avant 1881,
il n'existait pas d'écoles de jeunes filles musulmanes. Celles-ci recevaient dans
leurs familles, ou dans ce qu'on appelait « Dar el Maâlama » un
enseignement purement professionnel : coulure, dentelle, fabrication des tapis,
ménage.
La première école
de jeunes filles fut créée en 1898, à Tunis.
Quelques autres écoles
furent créées dans la suite mais le nombre des classes est tellement insuffisant
qu'on ne pouvait compter en 1928 que 2930 élèves dans les écoles du
Gouvernement : 17 candidates au certificat d'études primaires élémentaires
dont 13 reçues à cet examen.
Une critique très
sérieuse a été faite à l'enseignement des jeunes filles musulmanes. C'est qu'il
est, ou bien confié à des institutrices françaises qui ne connaissent en général
pas un mot de la langue arabe, ou bien à une musulmane qui n'a d'institutrice
que le nom.
Ce sont en effet, des
monitrices qui n'ont ni le certificat d'études primaires élémentaires, ni un
certificat d'arabe équivalent. On conçoit aisément qu'elles n'ont même pas de
formation pédagogique. Cela est d'ailleurs expliqué par la comparaison entre le
nombre 13 des élèves reçues au CEPE et le nombre 239 des élèves musulmanes à l'Ecole
Normale d'Institutrices, que donnent les statistiques du Gouvernement pour
l'année 1928. A moins que le nombre 239 ait été exagéré démesurément... pour leurrer
l'opinion publique.
Quoiqu'il en soit,
le reproche formulé contre les écoles des filles musulmanes est l'expression de
la réalité et que grand nombre de tunisiens n'osent envoyer leurs filles dans
des écoles formidablement surpeuplées, avec un personnel enseignant au-dessous
de sa tâche et où l'enseignement de la lague maternelle fait défaut.
Les Tunisiens ne
désarmeront pas avant d'obtenir l'ouverture d'écoles de filles, nombreuses,
suffisantes, avec un programme d'enseignement rationnel et un personnel de
choix.
9) L'ECOLE DU CRIME CEUX QU'ON ENVOI E A L'ÉCOLE DE DJOUGGAR
Le 6 novembre 1924
à 10 heures, une colonne de détenus s'arrêtait devant le bureau du chef. Ils étaient
tous jeunes, chétifs, loqueteux. Les plus âgés avaient quinze ans à peine. Ils
s'avançaient deux par deux, en rangs serrés.
Leur visage pâle
trahissait la joie de l'évadé. Car cette jeunesse malheureuse s'évadait de
l'atmosphère lourde du bâtiment H et de l'obscurité du cachot au grand air du
centre pénitencier de Djouggar.
Qu’ont-ils
fait et que vont-ils faire ? Qu’ont-ils fait ? Que sais-je ?
L'un a chipé peut-être un pain à la devanture d’un boulanger ; l’autre a
tiré la langue à un sergent de ville, celui-ci... celui-là...
Des juges implacables,
habitués recevoir les professionnels du vol et du crime, des cœurs insensibles à
la misère infantile, leur ont distribué généreusement quelques années de prison.
Dans la salle
commune de l'Hôtel Delord, chacun venait de nouer de nouvelles connaissances,
de raconter ses exploits et de recevoir des félicitations ou des critiques.
Certains y avaient même reçu des leçons pratiques. Ainsi le 15 septembre 1924,
dans la salle des prévenus arrivait un Ghomrasni. Il était d’assez grande taille,
mais il était jeune. Il avait seize, dix-huit... disons vingt ans, puisqu’on
l'avait mis avec les adultes. L'essentiel c’est qu’il venait de débarquer à
Tunis. Fils de la Montagne, il était rude, ignorant. La veille il était allé
vendre des beignets au marché central et voyant quelqu'un glisser un portefeuille
dans la poche externe de son veston, il avait cherché imprudemment à le lui
détourner.
Ignorance des lois
sociales ! Imprudence ! Non Les détenus amassés autour de lui pour écouter
son histoire n’y virent que de la maladresse. Ils le lui firent bien voire
d'ailleurs.
Mais les injures
cédèrent bientôt à un sentiment de pitié et les insulteurs devinrent des
professeurs pratiques. Ils endossèrent un veston à l'un d'eux, lui commandèrent
de se promener négligemment dans la salle et verbalement puis pratiquement enseignèrent
au Ghomrasni quelques méthodes de vol à la tire. Après quelques essais le Jeune
homme parvint à soutirer un mouchoir de la poche du veston sans attirer l’attention
du promeneur - et content de la leçon apprise, il regagna sa place au pied du
mur, en grognant : « je ne me ferai plus attraper. »
Voilà une leçon
pratique. Nous en connaissons d'autre que nous espérons rapporter un jour, quand
nous traiterons du régime des emprisonnés. Contentons-nous de dire pour le
moment que les enfants que la misère des parents et le manque d'écoles a livrés
à la rue et à la justice, apprennent dans les prisons tunisiennes l'oisiveté et
le crime ; alors que dans les pays où on a quelque peu le sens de
l'intérêt général, ils sont placés dans des maisons de correction -où les
gardiens sont instituteurs et professeurs de menuiserie, serrurerie etc.
En fait de maisons
de correction, nous avons en Tunisie des colonies pénitentiaires. Voici, dit le
chroniqueur judiciaire de la Dépêche Tunisienne, du 3 juin 1925, Mohamed Ben
Salah :
« Il est âgé de 15 ans. Deux condamnations
ornent déjà son casier judiciaire. Ce garçon d'avenir a volé un revolver et des
cigarettes. Il demande pardon en pleurant. Le Tribunal estime qu'il a agi sans
discernement, mais il a conquis le droit à une villégiature de six ans dans une
colonie pénitentiaire ».
L'une de ces
colonies, c'est Djouggar. Là, les jeunes détenus sont répartis en secteurs et
travaillent sous la surveillance d'un caporal : un détenu adulte. Le travail
journalier de chaque secteur est estimé d'avance. L'enfant gagne deux sous par
jour [6].
Les détenus logent
dans des salles recouvertes en tuiles. Le tabac, qui leur est défendu à la
prison, leur est autorisé à Djouggar.
Au lieu de construire
des écoles spéciales pour l'enfance arriérée ou malheureuse, le Protectorat leur
construit des prisons.
10) L'HOSTILITÉ DU GOUVERNEMENT A L'ÉGARD DE L'INITIATIVE PRIVÉE DANS L'ŒUVRE
DE L'ENSEIGNEMENT
Nous avons montré
dans la première division de ce chapitre que l'enseignement était organisé
avant le Protectorat par l'initiative privée sans le concours matériel de l’Etat.
Quand le
Gouvernement français prit à sa charge l'enseignement, cette initiative allait diminuer
par suite de l'appauvrissement progressif des Tunisiens, mais non s'éteindre.
Ce qui est intéressant à signaler à cet égard, c'est l'attitude du
Gouvernement. Au lieu de stimuler notre ardeur et notre élan pour notre relèvement
intellectuel par nos propres moyens devant l'insuffisance manifeste de son enseignement
et du nombre des écoles, le Protectorat s'est employé tout au contraire à
décourager l'initiative privée ; comme il s'est employé à décourager les étudiants
dans leur demande de modernisation de l'enseignement de l'Université.
L'enseignement privé
placé sous son contrôle, nul ne pouvait plus enseigner sans l'autorisation du
directeur de l'enseignement. Et cette autorisation ne s'obtenait pas toujours,
presque plus de nos jours, devons-nous dire.
Beaucoup plus caractéristique
est encore l'attitude toute récente du Gouvernement à l'égard des étudiants en
France. Le nombre de ces derniers, d’une ou deux unités avant la guerre a dépassé
la trentaine en 1927. Et si nous étudions la condition sociale et la situation
de fortune de tous ces étudiants, nous constatons qu'à l'exception d'une
dizaine appartenant à des familles relativement aisées, tous les autres étaient
pauvres et dénués de ressources.
La plupart avaient
bénéficié de l'enseignement secondaire gratuit du collège Sadiki. Ils étaient partis
en France se faire inscrire les uns comme surveillants et élèves dans des
collèges où ils préparent en même temps le baccalauréat ; les autres ayant
terminé 1er cycle secondaire au Lycée de Tunis prirent le bateau comptant pour subsister
sur une place de surveillant ou la subvention que continue à faire le Collège
Sadiki à ses élèves qui se rendent en France, la subvention de la direction de l'enseignement
et quelque aide familiale. Mais hélas, aucune de ces sources de revenus n'était
importante. La subvention du Collège variant avec le degré des études entre 1200
et 1800 francs et celle du Gouvernement n'excédant pas 2400 francs.
Des démarches faites
par les étudiants auprès du Gouvernement et des Grands Conseillers en novembre
et décembre 1928, appuyées par la presse tunisienne, fit porter le taux de la subvention
de la direction de l'enseignement à 3000 francs et à partir du 1er janvier 1930,
les subventions étaient remplacées par des prêts d'honneur[7].
Le caractère de cette
nouvelle institution avait porté à croire aux étudiants dénués de toutes
ressources personnelles et qui ne sortaient pas du Collège Sadiki que le taux de
ces prêts allait être assez important. Mais il fallut bien déchanter. Pour l'année
scolaire en cours (1930-1931), le taux de ces prêts d'honneur a oscillé entre
2000 et 4000 francs.
Le système des subventions
était, sans nul doute, plus avantageux. Passons. Disons plutôt que les étudiants
tunisiens en France ne s'étaient pas trop illusionnés sur l'intérêt que le
Gouvernement pouvait leur témoigner.
III) AVEC NOS PROPRES RESSOURCES ON NOUS REFUSE L'INSTRUCTION
Ne comptant pas sur
l'appui du Gouvernement, les étudiants avaient, dès le mois de décembre 1927, fondé
l'Association des Etudiants Musulmans Nord-Africains en France, dont le principal
but était de se procurer, par le système des cotisations et des fêtes, des ressources
pour permettre à ceux d'entre eux qui n'arrivaient pas, de boucler leur budget annuel.
Car si le travail extra-scolaire de surveillant, comptable, homme de peine dans
les magasins - n'a rien de déshonorant pour les étudiants, il n'en reste pas
moins vrai qu'il les surmène[8] et absorbe un temps
précieux pour leurs études.
Et bien, l'initiative
des étudiants avait rencontré en Tunisie autant d’hostilités de la part du
Gouvernement local, qu'elle avait rencontré d'enthousiasme de la part de la population
tunisienne. En effet, à peine les étudiants avaient-ils donné trois fêtes, deux
dans la banlieue de Tunis, à la Marsa et au Kram et une autre à Sousse, qu'ils avaient
reçu l'ordre de décommander une quatrième qu'ils projetaient de faire à Souk el
Arbaa et une autre à Hammam Lif (septembre 1929). Cette interdiction avait été maintenue
jusqu'à ce jour malgré les multiples démarches faites par le délégué de
l'Association, le Docteur Mahmoud El Materi.
La cause invoquée
par la Direction de l’intérieur pour justifier cette attitude a été des plus
inattendues. La voici, rapportée par le Docteur Materi lui-même dans « La Voix
du Tunisien » du 1er septembre 1930 :
« L'association
ayant son siège à Paris, nous la considérons comme une Société étrangère et
nous ne pouvons pas l’autoriser à organiser des fêtes à son profit et le
Docteur Materi d'ajouter : grande a
été notre surprise après une telle réponse ».
Et que pense-t-on
alors, en haut lieu de toutes les organisations italiennes, maltaises, grecques
philanthropiques et qui ne se contentent pas d'organiser des fêtes tapageuses,
mais font aussi des souscriptions non déguisées au profit des œuvres dont le
siège est à Rome, Malte, Athènes ou Jérusalem ? Mais nous n'avons pas voulu
embarrasser notre interlocuteur par une telle question ; nous lui avons
seulement demandé ce qu'il nous conseillait de faire pour lever l'interdiction
qui frappait nos fêtes pour lesquelles des sommes importantes avaient déjà été
dépensées et des artistes engagés.
« C’est bien simple, nous a-t-il
répondu ; vous n'avez qu'à constituer un comité de quelques membres
régulièrement mandatés par l'Association de Paris et faites-vous reconnaître à Tunis.
Je vous promets que vous ne rencontrerez aucune difficulté. Et surtout, a-t-il
ajouté, ne mettez rien sur les journaux à ce sujet. »
Notre Comité est
constitué depuis plus de cinq mois et nous avons fait tout ce qu'on nous a dit
de faire, mais jusqu'à présent la Direction de l'Intérieur n'a pas daigné nous
répondre.
Ainsi nous avons
perdu une année entière à faire démarches sur démarches sans obtenir aucun
résultat. Pendant une année, nous avons tenu notre promesse de ne pas saisir
l'opinion publique par la voie de la presse, toujours confiants dans les bonnes
dispositions de l'Administration. Maintenant, nous n'avons plus de raison de
garder le silence.
« Oui ! on nous empêche de venir
en aide à ceux de nos enfants qui poursuivent leurs études en France. Toutes les
chinoiseries administratives n'arriveront pas à voiler cette vérité brutale. »
Ainsi donc, avec
nos propres ressources, nos propres deniers, le Gouvernement du Protectorat nous
empêche de poursuivre notre instruction même dans les Universités françaises,
après s'être opposé à la modernisation de notre propre Université.
IV) RESUME DE L’ENSEIGNEMENT DEPUIS 1881
a) L'ancienneté de
notre Université, le nombre de ses professeurs et élèves avant et après
l'établissement du Protectorat ; le nombre des couttebs parsemés sur le territoire
de la Régence et l'importance de la population scolaire, pour un pays de deux
millions d'habitants ; les sacrifices matériels que cette population a acceptés
pour faire de l'enseignement un enseignement stable et gratuit à tous les
degrés ; l'esprit qui animait le ministre Khéreddine pour moderniser
constamment l'enseignement ; tous ces facteurs prouvent suffisamment que
proportionnellement à notre nombre, nous n'étions pas avant 1881, moins avantagés
en matière d'enseignement que la plupart des Etats modernes à cette époque.
b) Les luttes
vigoureuses, permanentes que nous avons livrées au Gouvernement du Protectorat
pour le décider à moderniser l'enseignement de l'Université de l'Olivier, pour
nous permettre d'ouvrir de nouvelles écoles privées, d'augmenter le nombre de
ses écoles, d'y introduire l'enseignement de la langue arabe ; d'ouvrir de
vraies écoles pratiques d'agriculture, de commerce et d'industrie ; de favoriser
l'enseignement supérieur par l'augmentation du nombre et du taux des prêts
d'honneur ; qu'à défaut de son argent, de permettre à la population d'aider
elle-même ses enfants ; tous ces facteurs prouvent que nous estimons l'instruction à sa propre valeur et que nous n'entendons
pas rester en retard sur les autres peuple ou nous contenter de l'enseignement
que dose à notre effet le Gouvernement du Protectorat.
c) Le nombre des
écoles primaires laïques ; le nombre des élèves tunisiens qui les fréquentent ;
le nombre de ceux qui ne trouvent pas de place dans ces écoles et celui de ceux
qu'on renvoie pour cause de limite d'âge ; le nombre de ceux qui ne
trouvent pas de places dans les écoles secondaires et celui qu'on y renvoie
pour cause de limite d'âge, comme si l'enseignement ne suffit pas d'être
aujourd'hui l'apanage des riches pour en frustrer encore ceux qui y sont
arrivés en retard ; le manque d'écoles
d'enseignement professionnel ; tous ces facteurs prouvent que l'œuvre
scolaire du Gouvernement du Protectorat est insuffisante pour une période de
cinquante années et un budget qui atteint le demi-milliard.
d) Le nombre des élèves
tunisiens dans les écoles primaires, comparé à celui de leurs camarades étrangers ;
la déviation pendant cinquante ans, du Collège Sadiki de son véritable but ;
l'hostilité du Gouvernement à l'égard des étudiants de l'Université de
l'Olivier et des étudiants de France, prouvent que le Gouvernement est réfractaire
à notre émancipation. Que, sans cette hostilité marquée, avouée, les Tunisiens auraient
certainement progressé beaucoup plus dans la voie de l'évolution
intellectuelle, économique et sociale.
e) Et de tout cela,
il faut déduire que l'œuvre scolaire du Gouvernement du Protectorat a pour but :
1) De former des
fonctionnaires dont il a besoin ou une main d'œuvre non spécialisée pour laisser
le privilège de la spécialisation et des hauts salaires aux ouvriers français.
2) D'empêcher la formation
des cadres parmi les Tunisiens capables de concurrencer les colonisateurs dans le
domaine économique ou de créer des difficultés à la colonisation.
3) Enfin d'asseoir
de plus en plus, sur le terrain solide de l'ignorance et de la pauvreté, la
PREPONDERANCE FRANÇAISE.
Une autre conclusion
s'impose également. La responsabilité de cette hostilité à notre émancipation
n'incombe pas au gouvernement seul, mais aussi au régime.
Le but de la
colonisation moderne est de trouver, en particulier dans les colonies, des marchés
pour approvisionner les usines de la métropole en matières premières et y
écouler leurs produits manufacturés.
Les métropoles
n'ont donc aucun intérêt à voir les habitants des colonies progresser dans l'échelle
du progrès intellectuel. Car ce progrès entraîne inévitablement le
développement de l'industrie locale et oppose par là même, l'intérêt de la
colonie à celui de la métropole.
Hier, c'était le
cas du Canada. Aujourd'hui, c'est le cas de l'Inde. Il s'en suit, que le
Gouvernement français n'a aucun intérêt à nous ouvrir des écoles - ou plutôt,
en nous ouvrant des écoles, car il est tenu de le faire vis-à-vis de l'opinion
publique -il devait en restreindre le nombre et proscrire du programme un
enseignement civique et professionnel vrai. Aussi, n'y a-t-il pas manqué.
L'enseignement est
une question de vie ou de mort pour nous.
C'est avec l'instruction
que le fellah modernisera ses moyens de production et échappera aux griffes de l'Usurier.
C'est l'instruction
qui introduira chez nous plus d'hygiène et de bien-être.
Et comme nous ne
pouvons compter pour cela, ni sur le régime du Protectorat, ni sur le
Gouvernement, il faut multiplier nos efforts, sacrifier nos ressources pour l'instruction
de nos enfants.
Ne supportons pas la
honte de laisser aux Français le soin d'écrire, pour nous, notre propre Histoire.
ECRIVONS NOUS-MEMES NOTRE PROPRE HISTOIRE.
PARTIE II : QUELQUES ASPECTS DU MILIEU SOCIAL
L'étranger qui
arrive dans un port quelconque de la Tunisie, distingue du pont du bateau qui
l'amène, deux populations différentes ; deux types ethniques qui opposent
déjà à son regard par l’expression du visage, son teint, le costume et le
couvre-chef.
Partout, en
Tunisie, l'enfant du pays, le jeune israélite excepté, se distingue aisément de
l'étranger.
A Tunis même, dont
la population est cosmopolite comme dans toutes les grandes villes, où une
partie de la jeunesse tunisienne a adopté par goût ou par commodité le costume
européen, on peut confondre de loin un Français avec un Italien ou un Maltais, tandis
qu'on reconnaît le Tunisien à son fez rouge écarlate. C'est là un signe qui ne trompe
jamais - et que le Tunisien, jaloux de son individualité, ne veut abandonner,
du moins dans l'état politique actuel de son pays, car le fez n'a pas d'autre
valeur à ses yeux. Il est de création turque et n'a pas la signification qu'on
a voulu lui attribuer.
Il y a longtemps
d'ailleurs que cette querelle entre les partisans du tarbouche et du chapeau a été
résolue par le cheikh Mohammed Abdou[9].
Ainsi donc deux
éléments de la population étant distincts nous traiterons dans ce chapitre de la
population tunisienne et de la population européenne.
LA POPULATION TUNISIENNE
I) MUSULMANTS ET ISRAELITES
La population tunisienne
se compose de deux éléments dont la seule distinction avant le protectorat
était la religion -mais qui s'éloignent aujourd'hui de plus en plus l'une de
l'autre dans les grandes villes et se différencient par plus d'un détail. Il s’agît
de la population musulmane[10] qui sans rompre avec son
passé, multiplie ses efforts pour imiter l'Occident dans tout ce qu'il a de bon ;
et la population israélite[11] qui, ne se voyant liée
par aucune civilisation antérieure, s'est lancée à imiter l'étranger à doses
massives et sans discernement.
Il y a aussi un autre
facteur qui avantage les israélites sur les musulmans dans leur acheminement
vers le progrès matériel. C'est leur condition économique avantageuse.
Les quelques industries
locales sont peu importantes et tenues indifféremment par les musulmans et les israélites.
Le commerce et les
banques sont dirigés par les israélites.
L'agriculture est
entre les mains des fellahs et des colons. Or, la bourgeoisie rurale a été appauvrie
au profit des colons et la masse des petits fellahs qui luttent contre
l'ignorance, la nature et le fisc, travaillent pour remplir leur ventre et le coffre
de l'Usurier. Or en Tunisie, l'usure est l'apanage de l'israélite, qui la
pratique sous ses formes multiples.
C'est ce déséquilibre
économique, le plus souvent favorisé par l'administration et le fait que les israélites
constituent une minorité citadine, qui ont permis dans une certaine mesure à
nos amis juifs d’évoluer plus vite que nous. Mais ce ne sont pas les seuls
facteurs de notre retard. Le fait qu’un peuple a la volonté de s’émanciper ne
hâte pas son émancipation. Il faut que ses efforts soient encouragés et
coordonnés par le Gouvernement.
Or que voyons-nous
en Tunisie ? Les enfants sont renvoyés des écoles publiques par milliers faute
de places et les ouvriers sont livrés à la pire exploitation morale et matérielle.
Le Gouvernement promulgue décrets beylicaux et arrêtes ministériels pour
protéger les ruines romaines, conserver le cachet oriental des villes arabes,
accorder le droit de vote aux commerçants et propriétaires fonciers, mais il
s’est refusé jusqu’à présent de faire bénéficier la classe ouvrière des lois de
protection du travail.
II) LE PROLÉTARIAT TUNISIEN
Le prolétariat
tunisien dans ses différentes classes : paysanne, ouvrière et
administrative, souffre non seulement de l’insuffisance des salaires, mais
aussi du fait que le Gouvernement lui refuse la possibilité de revendiquer un
salaire plus élevé et des conditions de travail plus avantageuses. Autrement
dit, il lui refuse le droit d’association et le droit de grève.
Lorsqu'en 1923 et
1924 les ouvriers tunisiens acculés à la lutte pour la défense de leur
condition matérielle, décidèrent de s'organiser en syndicats pour mettre de
leur côté quelques chances de succès, l’administration noya leur mouvement dans
le sang.
L'Etat tunisien, dans
sa forme actuelle, ne peut évidemment favoriser les employés au détriment de leurs
employeurs. En France, comme en Amérique, comme partout ailleurs, la classe
ouvrière n’a arraché le Droit syndical et la journée de huit heures que de
haute lutte. Mais là où son rôle devient vraiment criminel c'est quand il met à
la disposition des particuliers (colons, exploitations minières, etc.) les
détenus de droits communs pour les travaux les plus pénibles effectués dans les
plus cruelles conditions matérielles et morales, moyennant un salaire
journalier de quelques sous.
Ainsi, en 1928, le
nombre des journées de travail effectuées par les détenus chez les particuliers[12] , s'élève à 188 610
dont 102 759 dans les mines.
La Société des
Mines de Douaria, par exemple, emploie à l'extraction du minerai de fer du Djebel
Sedjenane près de deux cents détenus. C’est un véritable « enfer »
que le Djebel Sedjenane où pour une gamelle, 400 grammes de pain noir et
quelques sous par jour, les squelettes décharnés font douze heures de travail
sous la férule sauvage des gardiens.
C'est une « Montagne
de Malheurs » où l'Etat envoie « crever » ceux qu'il est chargé
de corriger et d'éduquer.
III) FONCTIONNAIRES ET TRAVAILLEURS DE L’ETAT
Pénible est la
situation des fonctionnaires et des travailleurs de l'Etat. A capacité égale et
travail égal deux fonctionnaires de la même administration ou deux ouvriers du
même service public, touchent des salaires différents parce que l'un est Tunisien
et l'autre Français. Ce dernier reçoit un traitement de base supérieur à celui
de son collègue ; l'indemnité du tiers colonial : LA MONSTRUOSITE
COLONIALE et il peut arriver au plus haut poste de l’administration, alors que son
collègue tunisien végétera dans les postes subalternes.
Ce favoritisme que
le Gouvernement s'obstine à maintenir malgré nos protestations indignées et
périodiquement renouvelées n'est-il pas la manifestation du principe de la
Prépondérance Française dans toute son iniquité et son absurdité.
LA POPULATION EUROPÉENNE
La population
européenne se compose principalement de Français, 71 020, dont près de dix
mille naturalisés (Italiens, Maltais et Tunisiens) de fraîche date et Italiens :
89 216 au recensement de 1926. Les statistiques de sources italiennes
accusent 120 000.
I) LES ITALIENS
Qu'ils soient
originaires de l'Italie du Nord ou de la Sardaigne et de la Sicile (les plus
nombreux et les plus pauvres à leur arrivée), les Italiens sont industrieux et
économes.
Encouragés et
aidés par le Gouvernement de la Péninsule, par l'intermédiaire des banques
italiennes[13],
sérieusement défendus par leur consul en Tunisie, ils achètent ou prennent à
bail un lopin de terre dès qu'ils ont amassé quelques ressources dans les
chantiers des travaux publics, où ils trouvent généralement de l'embauche en débarquant.
Ils plantent alors de la vigne qu'ils travaillent avec leurs enfants. Il est
également beaucoup d'italiens qui se sont fait naturaliser dans ces dernières
années[14] et obtinrent comme tels
des lots de colonisation de la Direction de l'Agriculture.
C'est là une
seconde colonisation, que la colonisation italienne favorisée et greffée sur la
principale, la colonisation française et qui est non moins dangereuse.
Car l'expérience
en Tunisie nous montre et l'expérience en Algérie est encore plus concluante,
que tous ces étrangers et surtout les néo-français, quand ils s'implantent dans
le pays, ne cultivent plus à notre égard que l'arrogance et la haine.
II) LES FRANÇAIS
Les français sont
principalement ou fonctionnaires ou colons, deux classes différentes par les
conditions de la vie et par le tempérament.
1) LES COLONS
« Grands »
ou « Petits » que l'année soit bonne ou mauvaise, les colons ont
l'oreille et l'appui du Gouvernement. Ils sont puissamment organisés pour
défendre leurs intérêts. Ils ont leurs groupements, leurs journaux et leurs
parlementaires. Leur politique n'a pas varié depuis l'établissement du Protectorat.
Ils sont pour le refoulement de l'arabe, pour la prépondérance française, avec
tout ce qu'elle a de force et de rigueur. C'est à prendre ou à laisser[15].
2) LES FONCTIONNAIRES
Les Fonctionnaires
sont moins organisés et moins puissants que les colons. Habitués à une vie
facile et monotone, à une discipline invariable, ils redoutent les risques de la
lutte. C'est à peine s'ils se dérangent pour un meeting sur la vie chère ou le
compte rendu annuel de leurs délégués au Grand Conseil. Ils sont en général libéraux,
mais d'un libéralisme qui n'engage pas l'avenir. Leurs partis, relativement
importants sont : l'Union des Syndicats de Tunisie C.G.T. et le Parti Socialiste
S.F.I.O. L'un et l'autre sont pour la Prépondérance Française. En voici les faits :
1) Ni le Parti Socialiste
ni l'Union des Syndicats n'ont manifesté la moindre réprobation, n'ont mené la
moindre campagne contre le « tiers colonial », la monstruosité
coloniale.
Ils prêchent l'égalité
des traitements entre tunisiens et français, cela est vrai. Le Parti Socialiste
a même prêté son appui au Parti Destourien à son début, cela est encore vrai ;
mais ils n'ont pas tenté jusqu'ici, de démolir le privilège injuste par son
essence et arrogant par son nom : le tiers colonial.
2) Le Parti
Socialiste et l'Union des Syndicats sont pour l'application intégrale à la Tunisie
de la loi française de1884 sur les Syndicats, malgré notre protestation. Voici la
résolution votée par le Congrès Syndical de l'Afrique du Nord, en 1930 :
« Le Congrès réclame pour les
travailleurs tunisiens et marocains, pour le droit syndical l'application de la
loi de 1884 et pour les indigènes algériens le droit de participer à la gestion
de leurs syndicats professionnels ».
Cette résolution a
été prise conformément aux conclusions des rapports sur le droit syndical pour
les indigènes, de MM. Delamarre (Algérie) et Bouzanquet délégué de l'Union des Syndicats
de Tunisie.
Or, la loi de 1884,
dont nous ne discutons par le principe de son application en France, stipule que
le bureau d'un syndicat, quel qu'il soit, doit être composé uniquement de
français - iniquité que Delamarre a dénoncée dans son rapport pour l'Algérie. -
Ce qu'on demande aux dirigeants d'un Syndicat, comme de tout autre organisme, même
patronal, c'est la capacité avant la nationalité. En appelant les travailleurs tunisiens
à faire partie du bureau syndical, le syndicat pourrait être la vraie école d'égalité
et de démocratie.
De quel droit et au
nom de quel principe, l'Union des Syndicats de Tunisie entend-elle enlever aux travailleurs
tunisiens la liberté de choisir leurs représentants au sein de leurs syndicats professionnels
dans leur propre pays. Est-ce parce qu'ils sont plus disciplinés et résistent
mieux dans les grèves que les ouvriers français ?
L'attitude de l'Union
des Syndicats et du Parti Socialiste dans la demande de l'application de la loi
de 1884 à la Tunisie telle qu'elle, ne s'explique que par le Principe de la
Prépondérance ou11rière française en Tunisie.
Le Parti
Socialiste ne reconnaît même pas en principe l'indépendance du peuple Tunisien :
« L'Indépendance du Peuple Tunisien est
un mot vide de sens... A la domination française succéderait une autre
domination européenne. Le Parti Socialiste déclare que, résolu à travailler pour
un avenir de conciliation, de progrès et d'indépendance véritable, il refuse son
appui à tout mouvement nationaliste et confessionnel parce que quelle qu'en
soit l'issue, un mouvement nationaliste travaille toujours pour la haine, la régression,
la servitude ».
Déclaration du
Parti Socialiste S.F.I.O. - Fédération de Tunisie - Février 1925.
3) CRITIQUES
Certes l'indépendance
du travail c'est l'indépendance véritable, mais l'indépendance Nationale en est
l'un des principaux stades. Cela est non seulement admis mais soutenu par les véritables
théoriciens du socialisme : Marx, Lénine, Jaurès. Nous n'insisterons donc
pas là-dessus, mais nous nous attacherons après tant d'autres à dissiper la confusion
que crée l'épithète « nationaliste » dans l'esprit des Socialistes tunisiens.
« En Occident, le mot nationalisme
évoque l'idée de politique, de revanche, de conquête, d'hégémonie militaire !
d’expansion territoriale. Il incarne en des figures, qui, sans remonter à Barrès
et Déroulède portent les noms de Maurras, Daudet, Hindenbourg. Ceci par le
nationalisme intégral avoué, cynique, tapageur » [16].
Mais, dans les
pays colonisés le mot nationalisme n'a pas le même sens. Il signifie plutôt
libération du joug étranger, affranchissement d'une collectivité de la tutelle
d'une autre collectivité.
Donc si en France nationalisme
égale impérialisme, en Tunisie nationalisme égale indépendance :
a) Le mouvement pour l'indépendance n'est
pas un mouvement confessionnel. Il n'oppose par le croissant à la croix. Ceux qui
en Tunisie, ont porté les plus rudes coups au maraboutisme, sont
incontestablement les Destouriens. Leur activité soutenue a fait fermer les
portes de bien de Zaouïas.
b) Il ne travaille pas pour la haine. Bien
au contraire. Il apaise et dissipe celle que nourrit l'esprit du vainqueur à
l'égard du vaincu et réciproquement, même quand le conquérant n'agit que dans
l'intérêt du soumis. C'est plutôt le régime colonial qui est le régime de la
haine par excellence. L'étranger ne pourrait maintenir sa domination dans un
pays quelconque que dans la mesure où il y agit en maître. Il s'en suit que
l'indigène ne pourrait se conduire, malgré lui en subordonné sans réagir au
moins par la haine. C'est la réalité de tous les jours, au Maghreb comme aux Indes.
C'est pour cette simple raison que, dans la lutte contre l'étranger, nous
voyons la classe ouvrière de Bombay, organisée et consciente, prêter son appui
à Gandhi et Nehru.
c) Le Nationalisme des peuples colonisés
n'est pas la régression. Le Peuple tunisien, tout comme les peuples Turcs, Egyptiens,
Indous, secoué par la guerre de 1914, le vacarme du machinisme, la brutalité
des actes des colonisateur, n'est-il pas en train d'adopter aujourd'hui les
mêmes moyens de production et de défense que les peuples occidentaux ; et
ce dans le souci de sa propre conservation, car la régression, le retour à la « féodalité »
est incompatible avec la Société moderne.
d) Enfin, l'argument : « à la
domination française succèderait une autre domination européenne », le
dada de tous les impérialistes français, n'est pas convaincant, surtout sous la
plume des socialistes.
Il y a d'abord à
compter avec les rivalités européennes, voire même internationales. Il y a
selon certains, la Société des Nations, fortement appuyée par la Seconde Internationale.
Il y a surtout la volonté du Prolétariat. Pourquoi pas une Tunisie indépendante
?
Il s'ensuit donc :
1) Que
le nationalisme Tunisien condamné par le parti Socialiste, est un mouvement de libération
nationale.
2) Qu'il
constitue un pas essentiel dans la libération individuelle.
3) Qu'il
n'est pas confessionnel.
4) Qu'il
apaise la haine des races et favorise leurs unions.
5) Qu'il
est un facteur de progrès social supérieur au colonialisme.
6) L'INDEPENDANCE
DU PEUPLE TUNISIEN EST UN MOT PLEIN DE SENS ET DE PROMESSES.
[1] Voir
Statistiques Générales de Tunisie, année 1928.
[2] Les
enfants riches, s'ils ont un mauvais numéro au tirage au sort peuvent se
racheter dans une certaine proportion.
[3] Voir la
Dépêche Tunisienne du 28 décembre 1929
[4] Monsieur
Gabriel Mérat, nommé en Octobre 1927.
[5] Monsieur Lucien Saint, la veille de son départ au Maroc.
[6] C'était
le salaire journalier des enfants en 1924.
[7] Décret
du 28 février 1930.
[8]
De 1928 à 1929 quatre étudiants tunisiens (trois israélites et un musulman)
dont trois surveillants d’internat étaient rentrés en Tunisie mourir de
tuberculose.
[9] Cadi du
Caire, en 1910.
[10] 1 864
908 unités au recensement de 1926.
[11] 53 022
unités au recensement de 1926.
[12] Voir
les Statistiques Générales de Tunisie, année 1928.
[13]
D'après l’enquête faite par le Gouvernement du Protectorat, vers 1926, sur la
hausse prodigieuse du prix de la terre et le rôle des italiens dans cette hausse.
[14]
Pour l'année 1928, sur un total de 855 naturalisations, les tunisiens entrent
pour 59 pour les musulmans et 213 pour les juifs et les italiens pour 449 naturalisations,
soit 52,5% du total.
[15] Consulter
la collection de leur journal : « Le Colon Français ».
[16] Nationalisme
impérialiste - Maurice Rimbault - L'Avenir Social, décembre 1924.

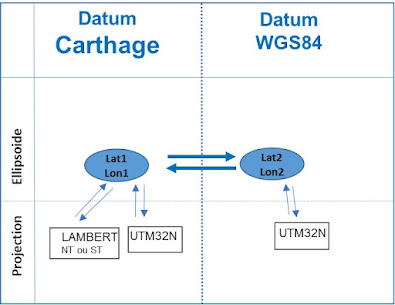


Commentaires
Enregistrer un commentaire